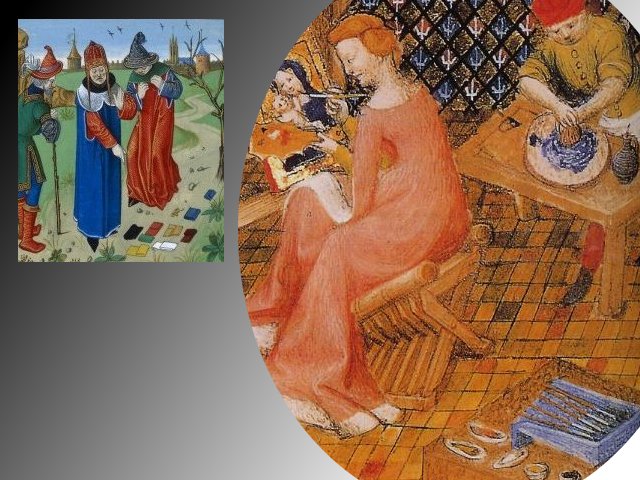

|
Choisir ses pigments |
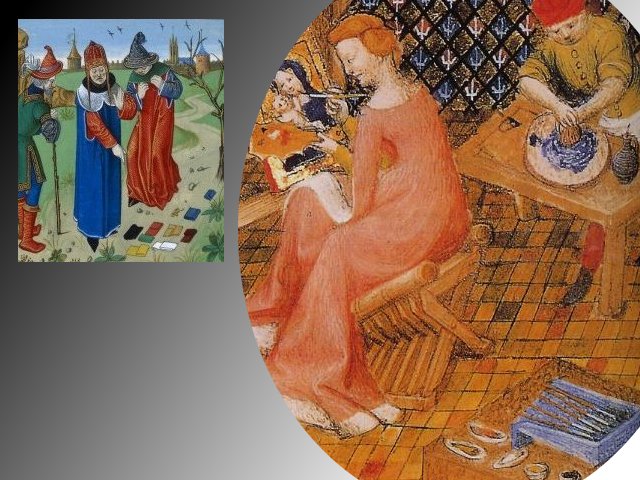

Les huit
matières ainsi
retenues sont répertoriées dans la dernière
colonne du tableau infra. Je les ai mises en correspondance avec leur
utilisation au XVe siècle. Les produits que
j’utilise sont empruntés à l’industrie du bâtiment
qui les destine à la coloration des enduits. A noter que les
pigments qualifiés aujourd’hui de rares, pour ne citer que
l’outremer véritable, l’azurite, le blanc de plomb ou le
vermillon fabriqué à la technique sèche, peuvent
encore être obtenus chez quelques spécialistes mais
n’entrent pas dans les considérations
énoncées ci-dessus. En revanche je devrais encore pouvoir
expérimenter le smalt * (non
répertorié dans le tableau) ou la garance.
Mes
vert, jaune, rouge, brun et noir actuels sont les minéraux de
toujours. Le bleu
outremer emprunte à la synthèse et le blanc est chimique.
De telles distinctions étaient déjà faites par
Pline. Pour mieux comprendre les contraintes que je m’impose il m’a
semblé utile de rappeler le contexte dans lequel
évoluaient les peintres médiévaux.
La composition de leur palette
était redevable à
l’antiquité tandis que les techniques s’inscrivaient dans une
loi générale de progression dont il convient de faire une
exception pour l’enluminure. Si l’on considère comme jalons
historiques l’abandon de la peinture à la cire, probablement au
début de la période romane, et l’état embryonnaire
de la peinture à l’huile, avant la Renaissance, il est
indéniable que la « tempera » caractérisait
le moyen-âge. Les manuels d’ateliers permettent d’observer divers
accroissements, améliorations ou essais
d’expérimentateurs parfois anonymes. Dans la chaîne de
traditions, le Libro dell’Arte, écrit au début du XVe par
Cennino Cennini occupe une place privilégiée. Des
renseignements complets sur diverses techniques y abondent ; la palette
y est riche. Trop axé sur la fresque dont il innove pourtant une
technique, il passe néanmoins pour archaïque à
l’époque ou les Van Eyck peignaient l’adoration de l’agneau
mystique. C’est pour cette raison que j’ai confrontés ces noms
dans mon tableau. Quant à Pierre Coustain, peintres des deux
derniers ducs Valois de Bourgogne, il était plus
spécialisé dans des travaux de décoration,
panneaux armoriés et étendards réalisés
à l’huile comme le faisait son prédécesseur
Broederlam en 1395 (P. Mantz, la peinture française du IX au
XVIe). Pour avoir un aperçu des relations qui peuvent
s’établir entre les principaux traités depuis
l’antiquité à ceux du XVe siècle, l’on peut se
référer à l’ouvrage de Guy Loumyer (voir
bibliographie). On y notera également le souvenir du secret dont
on entourait les connaissances techniques ce que démontre le
titre évocateur du manuscrit de Bologne « Segreti per
Colori » dont un extrait relatif à la teinture est traduit
sous http://www.elizabethancostume.net/dyes/segreti.htm
Théories chromatiques
A la lecture du
« De
Pictura »
d’Alberti, écrit en 1435, on se rend compte que celui qui a tant
fait pour relever la peinture au rang d’art libéral, se
démarquait très clairement des scientifiques dont le besoin de classification
était primordial.
Certains de
ces encyclopédistes sont étudiés dans
l’ouvrage de
Sylvie Fayet (voir bibliographie). L’humaniste insistait sur les
contrastes qu’il qualifiait d’amitié et arguait qu’en se
joignant, une couleur conférait à l’autre grâce et
vénusté. Il opposait le clair au sombre tout en
dénigrant quelque peu le texte fondateur d’Aristote et de ses
suiveurs puisqu’il niait la bipolarité du blanc et du noir. Il
ne s’appuyait que sur quatre repères universaux de couleur dont
les éléments fournissaient la trame de
référence dont résultaient de multiples
espèces tandis que leur mélange avec du blanc ou du noir
en produisait d’autres en nombre presque infini. C’est aussi avec une
remarquable part d’intuition que Cennino Cennini dont la filiation
spirituelle avec Giotto est connue, anticipait avec trois bons
siècles d’avance l’appariement goethéen des couleurs
complémentaires lorsque, il décrivit la manière de
peindre un visage en superposant graduellement le cinabre au vert.
Mélanger, travailler l’ombre et
la lumière !
Tendre vers le blanc permet de
rendre la
lumière ! C’est une évidence pour tous mais qu’en est-il
de l’ombre ? La mort de la lumière entraînant celle de la
couleur, Alberti prétendait l’éteindre par du noir.
Partir d’une pleine saturation puis éclaircir les tons en
demi-teintes constitue une bonne alternative. C’est cette
dernière manière préconisée par Cennini,
que je privilégie. Avec le maître
toscan du XIVe
cité plus haut, l’image était déjà devenue
tridimensionnelle. Au cours du siècle qui suivit, une plus large
généralisation de la technique à l’huile ne
pouvait qu’amplifier le réalisme des scènes en y ajoutant
la transparence. Qui n’a jamais été stupéfait en
tombant sur des portraits de donateurs qui rendent le culte
d’hyperdulie accompagnés de saints protecteurs comme s’ils
avaient été invités à domicile ? Encore
s’agissait-il de s’approprier les pigments pour parvenir à ce
stade d’excellence.
Inimitié des matières
Les veines
géologiques, la
transformation de la matière par calcination, l’alambic, les
sous-produits de l’industrie textile ou du verre offraient une richesse
variée de matières colorantes, lesquels n’étaient
cependant pas toujours compatibles. Certains comme le vert de gris et
le blanc de plomb s’entretuent. L’air, la lumière et le temps
sont d’autres ennemis dont il fallait parfois se prémunir.
Couchés sur les pages d’un manuscrit les pigments ne craignent
que peu la lumière. A fresque, ils demeurent au contact de l’air
tandis que sur panneau ils sont enveloppés par l’huile ou
peuvent être volontairement isolés par de la colle. C’est
pour cette raison que, sur les murs, Cennini traite les visages et la
peau des personnages au cinabrese alors qu’il recommande le cinabre
lorsqu’il s’agit de panneaux encollés ou à l’huile. A
l’instar du minium, ce pigment devient noir au contact de l’air. On
sait aussi que le vert de gris a fini par percer la peau de parchemins
et que les feuillages peints sur panneaux ont noirci avec le temps.
L’huile, qu’elle serve de liant ou de vernis donne un ton plus
foncé aux couleurs qui peut surprendre.
Broyer
 Pour certains pigments, plus le nombre de
particules est élevé, meilleure est la diffusion de sa
couleur. L’intensité dépend donc de la finesse du
broyage.D’une demi-heure à une année pour le noir,
quotidiennement pendant 20 ans pour le cinabre auraient
constitué un plus appréciable (Chap. XL). On voit que
Cennini ne lésinait pas dans ses propos. Après tout
c’était un travail d’apprenti. L’auteur du célèbre
traité déléguait également aux femmes le
plaisir de pétrir le lapis lazuli (Chap. LXII). Toutefois, en
règle générale, il préconisait d’acheter
les pigments chez l’apothicaire tant il est vrai que certains servaient
également de médicaments. Il en précisait
également la forme pour échapper aux falsifications. Au
chapitre XXXVI du « Il Libro dell’Arte » il recommandait :
«Pour broyer prendre de préférence du porphyre
clair pas trop poli de la longueur d'un demi-bras sur chaque
côté. Une autre pierre de porphyre, plate dessous, conique
par en haut de la forme d'une écuelle doit être pouvoir
tenir dans la main. Mettre sur la pierre la valeur d'une noix de [noir]
et la mettre en poudre en versant dessus de l'eau claire en la broyant
le temps qu'il faut. Ramasser la couleur avec un morceau de bois mince,
large de trois doigts qui ait un taillant comme un couteau. Mettre la
couleur dans un vase.» La plaque pouvant aussi être en
marbre, j’ai eu moins de difficulté à me procurer cette
dernière pierre. Pour broyer les couleurs à l’huile je
remplace l’eau par de l’huile de lin. Pour mieux comprendre le principe
de diffusion ou pourquoi l’huile fonce les pigments, je recommande le
traité des couleurs http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/traite-des-couleurs-9782880744304
malheureusement épuisé (voir bibliographie).
Pour certains pigments, plus le nombre de
particules est élevé, meilleure est la diffusion de sa
couleur. L’intensité dépend donc de la finesse du
broyage.D’une demi-heure à une année pour le noir,
quotidiennement pendant 20 ans pour le cinabre auraient
constitué un plus appréciable (Chap. XL). On voit que
Cennini ne lésinait pas dans ses propos. Après tout
c’était un travail d’apprenti. L’auteur du célèbre
traité déléguait également aux femmes le
plaisir de pétrir le lapis lazuli (Chap. LXII). Toutefois, en
règle générale, il préconisait d’acheter
les pigments chez l’apothicaire tant il est vrai que certains servaient
également de médicaments. Il en précisait
également la forme pour échapper aux falsifications. Au
chapitre XXXVI du « Il Libro dell’Arte » il recommandait :
«Pour broyer prendre de préférence du porphyre
clair pas trop poli de la longueur d'un demi-bras sur chaque
côté. Une autre pierre de porphyre, plate dessous, conique
par en haut de la forme d'une écuelle doit être pouvoir
tenir dans la main. Mettre sur la pierre la valeur d'une noix de [noir]
et la mettre en poudre en versant dessus de l'eau claire en la broyant
le temps qu'il faut. Ramasser la couleur avec un morceau de bois mince,
large de trois doigts qui ait un taillant comme un couteau. Mettre la
couleur dans un vase.» La plaque pouvant aussi être en
marbre, j’ai eu moins de difficulté à me procurer cette
dernière pierre. Pour broyer les couleurs à l’huile je
remplace l’eau par de l’huile de lin. Pour mieux comprendre le principe
de diffusion ou pourquoi l’huile fonce les pigments, je recommande le
traité des couleurs http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/traite-des-couleurs-9782880744304
malheureusement épuisé (voir bibliographie).
Tableau
sélectif
Le tableau qui
suit compare ma
sélection de huit
pigments avec celle dont disposèrent les trois peintres des
XIX-XVe siècle déjà cités.
La colonne Van
Eyck (14 itérations) est tirée des
résultats de
l’étude suivante : La technique des "Primitifs flamands": Etude
scientifique des matériaux, de la structure et de la technique
picturale. III. Van Eyck: l'Adoration de l'Agneau Mystique (Gand:
Cathédrale Saint-Bavon) Paul Coremans Studies in Conservation,
Vol. 1, No. 4 (Oct., 1954), pp. 145-161 (article consists of 17 pages)
Published by: International
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works
Stable
URL: http://www.jstor.org/stable/1505018
Les détails de l’œuvre peuvent être visionnés sous
le lien:
http://bib18.ulb.ac.be/cdm4/results.php?CISOOP1=exact&CISOFIELD1=CISOSEARCHALL&CISOROOT=all&CISOBOX1=Gand%20,%20Cath%C3%A9drale%20Saint-Bavonhttp://www.lumiere-technology.com/ipn_50_French.pdf
L’avenir est d’ailleurs très prometteur
dans ce domaine
d’étude lorsqu’on considère les possibilités
très impressionnantes offertes par l’imagerie multispectrale
: http://www.lumiere-technology.com/ipn_50_French.pdf
La colonne Cennino Cennini (30
item) est tirée du traité
« Il Libro dell' Arte ». Voir bibliographie
La colonne
Coustain (12 item) est
reconstituée à partir des comptes
que l’on pourra consulter sous ce lien. Cinq couleurs ne sont pas
identifiables
pour moi ce qui illustre bien les difficultés
d'interprétation et de
confusions qui ont marqué l'histoire :http://books.google.ch/books?id=4kgPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q=4697&f=false
Coustain était peintre de cour et participa à diverses
besognes indispensables au decorum fastueux des chapitres de la Toison
d'Or.
Une autre question m’a parue fondamentale à la lecture de ces
comptes : Pourquoi chauffaient-ils les couleurs qui de toute
évidence étaient à l’huile de lin rendue siccative
par du vitriol ? L’usage de cire pour faire les patrons n’est pas
à négliger non plus.
Tableau
| |
|
|
||
 (détail) (détail) |
 La
colère , fresque de Giotto La
colère , fresque de GiottoA voir sous ce lien |
 (chapitre de
la Toison) (chapitre de
la Toison) |
||
| Van Eyck | Cennino Cennini (pas d’œuvre attribuée) | Coustain | ma sélection | |
| Bleu | Outremer (lapis-lazuli) | idem | |
Idem (synthèse) |
| |
Azurite (Azur d'Allemagne) | Idem | Azur d'Allemagne | |
| |
|
Indigo + Blanc
|
Délié
azur ?
Florée, ou fleurée. Voir infra |
tenté par le Smalt |
| Vert | copper resinate | |
|
|
| |
malachite | Vert-azur (une variante de l'azurite, à ne pas trop broyer) | |
|
| |
|
Terre-verte (mordant à dorer) | |
Idem |
| |
|
Vert-de-gris (ne pas l'approcher du blanc) | vert de glay (ou d'iris) | |
| |
|
(5 mélanges) | |
|
| Jaune | lead-tin oxide | |
|
|
| |
non-identified | |
|
|
| |
yellow ochre | Ocre | Ocre pour assise | idem |
| |
|
Giallorino (J. de Naples, pas trop broyer) | machicot(massicot?) pour roches | |
| |
|
Orpin (ne convient pas à fresque, toxique) | |
|
| |
|
Risalgallo (Jaune minéral Toscan) | |
|
| |
|
Safran | |
|
| |
|
Arzica (pour miniaturistes) | |
|
| Rouge | red ochre | Sinopia ou porphyre (Terre où se trouve le souffre) | Cynopre pour blasons | 2 terres |
| |
Vermilion (synthèse) | Cinabre (alambic. A broyer 20 ans) | Vermillon pour naves | en tube uniquement |
| |
Madder lake (garance) | Laque (Garde-toi de la bourre de soie, prend la gomme) | Bois de Brésil pour rose | |
| |
|
Sang de dragon (Résine) | |
|
| |
|
Sanguine (Pierre si serrée qu'elle permet de brunir l'or) | |
|
| |
|
Minium | |
|
| |
|
Cinabrese (mêlé à la chaux pour le rose des fresques) | Rose (laque rose de Paris) | |
| Brun | brown ochre | |
|
idem |
| |
non-identified | |
|
|
| Noir | animal black | |
|
|
| |
|
Pierre tendre | |
idem |
| |
|
Sarment de vigne brûlé | |
|
| |
|
Cosses d'amandes ou noyaux de pêche | |
|
| |
|
Suie | |
|
| Blanc | white lead | idem (A broyer tant et plus) | Blanc de plomb | Blanc de zinc |
| |
|
Blanc de St-Jean (chaux effluvée pour fresque) | Craie broyée pour roches | |
| |
14 | 30 | 12 | 8 |
Remarques
complémentaires :
*Le smalt est un bleu
(cobalt/arséniures nickel) dont l’invention serait
attribuée à Christoph Schürer fabriquant de verre de
Bohème entre 1540 et 1560. Pourtant Dirk Bouts l’aurait
utilisé pour sa « Mise au tombeau » de 1455.
Oublié pendant le MA, il serait le bleu mâle de
Théophraste opposé au bleu femelle, dérivé
du cuivre. (Berthelot : Les Origines de l’Alchimie- Les métaux
chez les Egyptiens)
Lapis-lazuli
Peut-être le cyanos
autophyès de Scythie distingué par Théophraste.
L’Azzurum transmarinim est entré en usage courant au XIVe
siècle. Les textes orientaux le signalaient fréquemment
au XIIIe siècle. Selon Laurie (The Pigments and Mediums of the
old Master), la matière précieuse aurait
été utilisée dès le septième
siècle pour certains manuscrits byzantins et occidentaux. Les
fonds de nombreuses miniatures auraient été
dénudés dans le but de faire resservir la matière
colorante. L'outremer de synthèse possède la même
composition chimique.
Au sujet de la synthèse il est intéressant de noter
le bleu
d'Alexandrie du
début de l'époque pharaonique et
la recette antique
du
lapis-lazuli synthétisé ainsi que
sa zone de diffusion sur ce lien du CNRS:
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/couleurs/loupe_pigments3.html
Indigo
Les romains s’en servaient pour la peinture et le
recevaient directement de l’Inde. Il est cité dans les tarifs de
Marseille de 1228. Nommé, en Italie, indigo bagadel,
entre-autres dénominations, Jean le Bègue écrit
« inde de Bandas, c’est-à-dire- Baguedel. La guède
et le pastel furent des succédanés qui entravèrent
longtemps le commerce du véritable indigo. J’ai trouvé du
pastel en vente dans la région de Toulouse.
Concernant les plantes indigofères on lira avec
intérêt l'article suivant de la revue d'histoire de la pharmacie : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pharm_0035-2349_1990_num_78_284_3031
Florée, flourée ou fleurée
L'écume
recueillie à la surface de la cuve de guède, de pastel ou d'indigo, était de la matièrecolorante
à l'état pur.
On dit aussi fleurée pour l'écume
légère qui se forme à la surface de la cuve du bleu , lorsqu'elle est
tranquille.
Il s'agit
d'un beau bleu qui vient nager à la surface des cuves au pastel et annonce que
tout s'y passe convenablement.
Vert de cuivre
«
Semence de Vénus » en terminologie alchimique. Ce vert
occupait une place importante sur la palette des peintres mais son
altérabilité les préoccupait.
Résinate de cuivre
Sel de cuivre dissout dans la térébenthine de Venise. Il
permet d'obtenir une saturation profonde en application par glacis.
Terre verte
Pierre de
S. Audomar conseillait de mêler du « viride terrenum
» au vert de cuivre de couleur médiocre.
Vert d'iris
Le
vert d'iris était le principal vert et le plus cher; il fallait
piler les
feuilles des fleurs d'iris, mettre dans un linge neuf ces fleurs
pilées et
exprimer le suc que l'on mêlait à de l'alun en poudre : on
faisait sécher ce
suc en coquilles. (Bulletin des commissions royales d'art et
d'archéologie,
année 1883) dans lequel est encore précisé :
Avant
le XVIe siècle il existait pour ainsi dire une méthode
septentrionale et une méthode
italienne pour les couleurs. Aussi, quand nous traiterons plus loin des
substances employées par les Italiens, trouverons-nous quelques
différences de
dénominations et mémo de matières
employées.
Mais
l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre avaient une sorte
de
palette commune dont les matériaux étaient pour la
plupart originaires de l'un
de ces pays. Le jaune de Naples, seul, très usité en
Italie, parait avoir été
peu connu ou très rare dans le nord et pourtant au XVIe
siècle on employait au
delà des Alpes le jaune
de Flandre...on
a fait de nombreux essais pour le reconstituer et l'on s'est
arrêté à
l’hypothèse d'un jaune d'antimoine.
Rouges
La confusion
des miniums et autres cinabres qui peuvent même porter le nom
d’açur chez les auteurs alchimiques est totale. Je ne peut
m’empêcher de faire une relation avec le glissement
sémantique du sinople héraldique dans l’ancien
français qui passa brusquement du rouge au vert sans que l’on
n’en connaisse la raison. http://leherautdarmes.chez.com/emaux.html
Une
mise au point me semble malavisée dans le cadre de ce blog.
Blanc
Lorque l'industrialisation du blanc de plomb a été
interdite pour des raisons de sécurité, il a
été remplacé par le blanc de zinc que j'utilise.
Ce dernier est plus blanc et a surtout pour inconvénient
d'être moins siccatif avec l'huile.
Bibliographie et ouvrages de référence
Alberti,
De
Pictura, traduit par J.-L. Schefer, Macula Dedale, Paris 1992
Cennino
Cennini, Le Livre de l'Art, mis en lumière avec des notes par le
chevalier G. Tambroni et traduit par Victor Mottez.
Daniel V. Thompson,
The materials and techniques of medieval painting, Dover Publication,
1956
Histoire vivante des couleurs : 5000
ans de peinture
racontée par les pigments / Philip Ball
Traité des
couleurs / Libero Zuppiroli, Marie-Noëlle Bussac ; avec les
photogr. de Christiane Grimm
Sylvie Fayet, Le regard scientifique
sur
les couleurs à travers quelques encyclopédistes latins du
XIIe siècle. Bibliothèque de L'Ecole Des Chartes, Volume
127, Partie 2
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1992_num_150_1_450643
Pline,
Liber XXXV : http://books.google.ch/books?id=oKJhAAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_slider_thumb#v=onepage&q&f=false
Guy
Loumyer, Les traditions technique de la peinture
médiévale. Slatkine Reprints, Genève 1998
 par Francis
Besson, juillet
2010
par Francis
Besson, juillet
2010