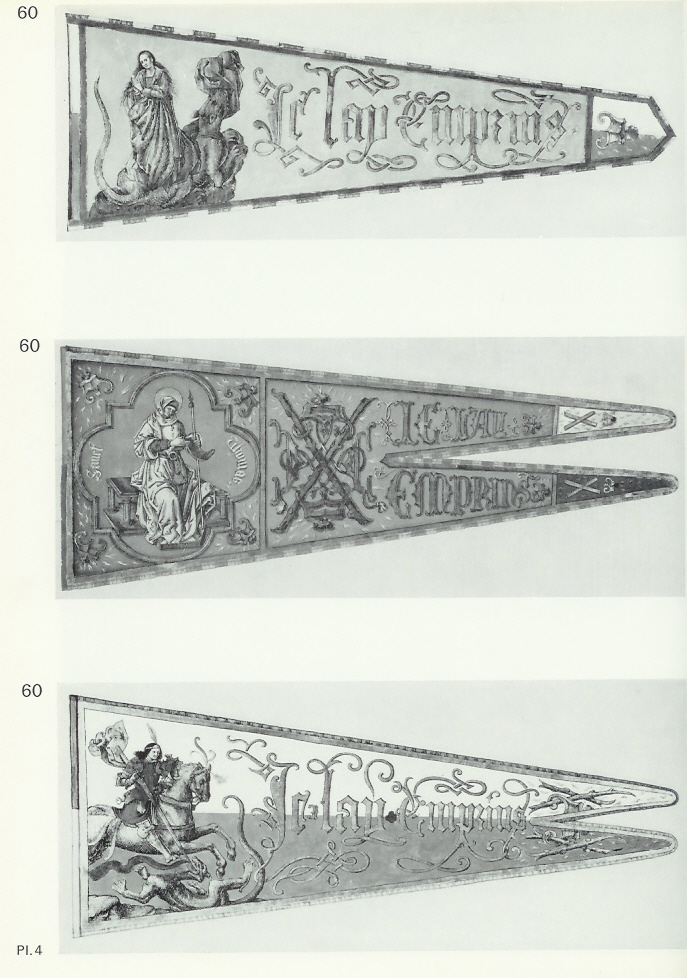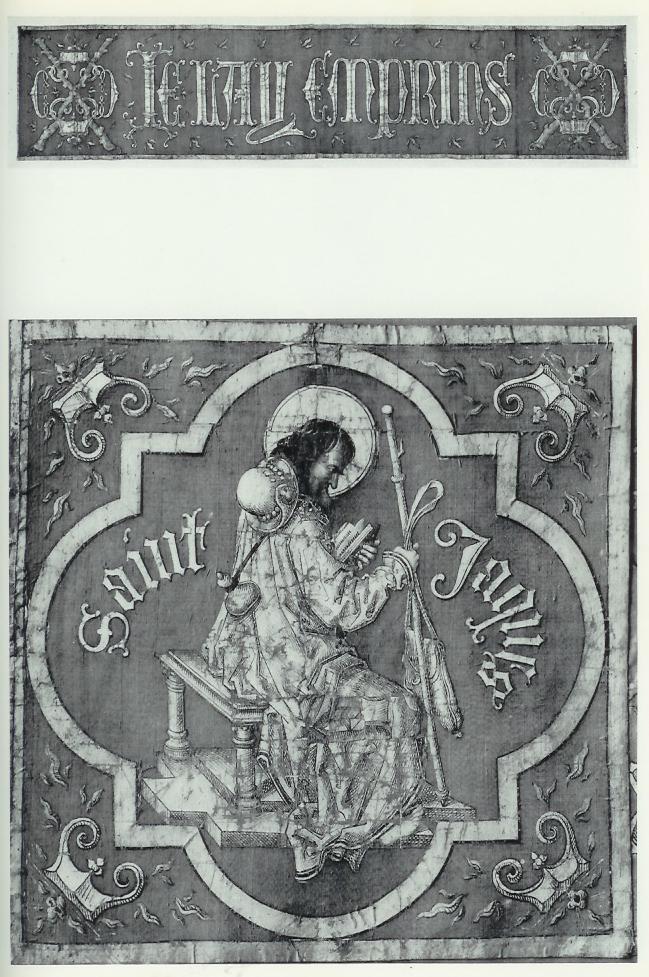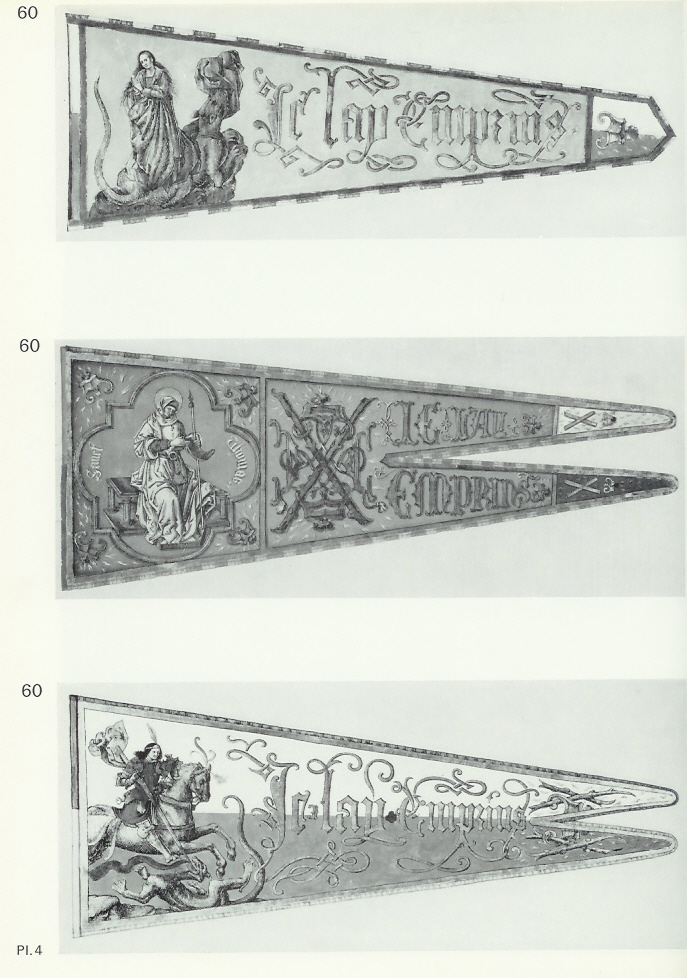
MUSEE D’HISTOIRE DE BERNE
LE BUTIN DES GUERRES DE BOURGOGNE ET ŒUVRES D’ART DE LA COUR DE BOURGOGNE
MAI-SEPTEMBRE 1969
LES DRAPEAUX
BOURGUIGNONS
Les
Confédérés attribuaient une importance particulière aux drapeaux pris
comme butin. La prise de possession d'une enseigne militaire signifiait pour les
troupes dépossédées la perte d'un signe de ralliement important et saint et
équivalait à une défaite; pour le vainqueur, cette prise s'identifiait à la
victoire et justifiait son combat. Les drapeaux obligeaient directement leurs
porteurs; ils étaient le symbole de l'Etat et étaient hautement honorés; ils
étaient consacrés, le guerrier prêtait le serment au drapeau et s'engageait
à la fidélité en les touchant. Les drapeaux qu'on n'emportait pas en
campagne n'étaient pas seulement conservés dans les arsenaux mais aussi dans
les églises. Si les enseignes perdues possédaient un caractère religieux qui
sanctifiait aussi le combat de leurs porteurs, le vainqueur voyait dans leur
perte un jugement divin. Ces conceptions qui sont surtout connues et prouvées
pour le haut Moyen Age subsistaient sans restrictions à l'époque des guerres
de Bourgogne.
Parmi
les drapeaux qui tombèrent aux mains des Confédérés pendant les guerres de
Bourgogne, il faut nettement distinguer deux groupes: premièrement les
enseignes militaires arrachées des mains de l'ennemi pendant le combat et deuxièmement
les drapeaux trouvés dans des caisses de provisions dans le camp du duc.
Tandis que les bannières du premier groupe appartenaient aux conquérants,
les drapeaux de la seconde catégorie - il s'agissait vraisemblablement de
trente bannières principales - furent apportés à Lucerne pour le partage de
l'ensemble du butin. Ces drapeaux saisis et conquis sont en partie conservés
en Suisse, jusqu'à nos jours, car ces trophées ont été soigneusement gardés
dans des églises et des arsenaux pour y commémorer des gloires passées.
Les
drapeaux ont rarement été transformés en ornements d'église. Beaucoup des
enseignes militaires tombèrent littéralement en bribes, les couleurs se
modifièrent et consumèrent le tissu. Depuis le 17e siècle des «Livres des
drapeaux» furent établis sous forme d'index illustrés, en couleurs, destinés
à transmettre les trophées à la postérité au moins en images (voir N°S du
cat. 49-65). Bien plus, des drapeaux furent copiés sur de la toile et
reproduits à la fresque sur des parois d'églises ainsi que peints sur des
planches que l'on suspendait à la place des originaux.
Il faut distinguer parmi les
enseignes militaires bourguignonnes
La banière, grande bannière héraldique
rectangulaire.
L'estandart, étendard
triangulaire à images de saints, emblèmes héraldiques et proverbes.
La cornette
rectangulaire
oblongue
à emblèmes et images de saints.
Les
baneria diversi coloris, que mira pictura decorabat
et
toutes ces vexilla et baneria aureis litteris inpicta posent une série
de problèmes concernant l'histoire militaire et l'histoire de l'art qui sont
brièvement traités dans Deuchler, 370 s.,
Exkurse
V et VI. On se
contentera ici d'aborder l'aspect relevant de l'histoire de l'art. A cet égard, les trophées
conservés en Suisse présentent un intérêt particulier car ils représentent
les plus anciennes enseignes militaires conservées provenant des régions
qui s'étendent de la Bourgogne à la France septentrionale. Les drapeaux du
temps de Philippe le Hardi et de Philippe le Bon, qu'on pouvait encore admirer
dans l'Hôtel de Ville de Dijon au 18e siècle, ont disparu depuis longtemps.
Les
enseignes militaires bourguignonnes à images de saints, bien que formant un
groupe à peine pris en considération comme témoin du passé, peuvent jeter
un jour nouveau sur l'ancienne peinture néerlandaise. Les sources révèlent
que des peintres de tableaux renommés ont aussi fait des drapeaux. Les
enseignes militaires conservées à Soleure, Berne et Saint-Gall ne proviennent,
il est vrai, pas directement de l'atelier d'un des grands maîtres de la fin
du 15e siècle mais leur style permet de les rapprocher de l'entourage des
Dirk Bouts, Hugo van der Goes ou Jehan Hennequart et Pierre Coustain.
Au
temps de Charles le Téméraire, deux peintres de drapeaux semblent avoir été
particulièrement souvent à l'œuvre: Pierre Coustain et Jehan Hennequart. La
première commande de drapeaux faite par Charles, qui date des années
1467/1468, a la teneur ci-après: A Jehan Hennequart, var/et de chambre et
paintre de MdS, pour la façon du grant estandart de MdS, de taffetas
blanc, ou a esté paint et figuré, à deux endroits, /'ymage de MS Saint
George à cheval, combattant le dragon et y a été escript de grant lettre d'or
le mot et devise de MdS... (L. de Laborde, Les ducs de Bourgogne, Preuves, 1,
Paris 1849/1852, 503-504, N° 1968). Il apparaît clairement que le
drapeau de Saint Georges à Soleure présente une filiation directe avec cette
enseigne (voir la copie dans le Livre des drapeaux soleurois, N° du cat. 62).
Pierre Coustain est nommé pour la première fois en 1472. Jehan Hennequart a reçu
des honoraires pour la façon ... d'estandars, banières, penons, guidons et cornectes
que MdS ... a présentement ordonné par dessus ceulx que
Pierre Coustain, mon compaignon, a derrenièrement faiz (L. de Laborde,
Les ducs de Bourgogne, Preuves, Il, Paris 1849/1852, 226, N° 4039).
Une
des dernières commandes de Charles faite en 1474, au camp de Neuss, a été
commentée par Commynes avec d'abondantes informations, malheureusement sans les
noms des peintres chargés de ce travail:
En
ce temps le Duc fit faire de grands Estendarts avec /'Image de sain et George,
des Guidons et des Cornettes pour les differens Estats de son Hostel, Archers de
corps et de la grande garde, et pour les vingt compagnies d'ordonnance; le
premier des Estendarts de ces compagnies étoit en champ d'or, avec /'image de
sain et Sebastien, le mot et la devise de Monseigneur le Duc, garni de fusils,
de flambes, et de la Croix de sainct André. Le 2.
avait /'image de sain et Adrien en champ d'azur; le 3. /'image
de sainet Christophe en champ d'argent; le 4. sainet Anthoine en champ
rouge; le 5. sainet Nicolas en champ vert; le 6. sain et Jean
Baptiste en Champ noir; le 7. sain et Martin, sur drap sanguain; le 8.
sainet Hubert, sur gris; le 9. sainete Catherine, sur blanc;
le 10. sainet Julien, sur violet; le 11. sainete Marguerite, sur tanné;
le 12. sainete A voye, sur jeaune; le 13. sain et
André, sur noir et violet; le 14. sainet Estienne, sur vert et noir; le 15.
sainet Pierre, sur rouge et vert; 16. sainete Anne, sur bleu et
violet; le 17. sain et Jacques, sur bleu et or; le 18. sainete
Magdelaine, sur jeaune et bleu; le 19. sainet Jerosme, sur bleu et
argent; le 20. sainet Laurent, sur blanc et gris. (Philippe de Commynes, Les
Chroniques de Louis de Valois, Roi de France ... depuis l'an 1460 jusqu'à 1483,
autrement dites « La Chronique scandaleuse», publiée par Lenglet de
Fresnoy, Londres/Paris 1747, Il, 214).
Les
drapeaux conservés en Suisse peuvent indubitablement être mis en relation
avec cette commande. Les notations des couleurs que l'on trouve dans le
texte de Commynes correspondent à celles des originaux et à celles indiquées
dans les livres des drapeaux, en particulier dans l'exemplaire de Glaris (voir
N° du cat. 60) sauf pour quelques variantes insignifiantes. Nous possédons
ainsi des points de repère pour la datation t des drapeaux qu'on peut
identifier avec la commande de Neuss. Il est frappant de constater que t précisément
le drapeau très ancien de saint Jean l à Soleure (voir la copie dans le Livre
des drapeaux soleurois N° du cat. 62) n'est pas mentionné 1 par Commynes. A.
Châtelet s'est rattaché à l'hypothèse selon laquelle l'auteur du drapeau de
t saint Georges à Soleure pourrait être rapproché j de Jehan Hennequart (Résurrection
de Pierre Coustain, dans Bulletin de la Société de l'histoire é de l'art français,
1962, 7-13).
"
Châtelet
a tenté d'attribuer quelques-uns des drapeaux à Coustain et d'autres à
Hennequart, _ en se fondant sur la critique des styles. K.Arndt estime par
contre que, « pour diverses raisons », aucun
de ces deux artistes ne peut être pris en
considération (Zum Werk des Hugo van der c Goes, dans Münchner Jahrbuch
der bildenden
_
Kunst,
XV, 1964, 63-98). Arndt place plutôt le ri drapeau de saint Etienne, de
Saint-Gall, dans l'entourage immédiat d'Hugo van der Goes (voir la e copie dans
le Livre des drapeaux, N° du cat. 65). r: (Sur la similitude des styles voir
Deuchler, 373). a Le drapeau a été restauré de telle manière qu'il s n'est
plus possible d'établir si cet artiste l'a exécuté de sa main.
Un
classement stylistique concluant n'a pas encore été fait. L'état dans lequel
se trouvent les drapeaux leur a fait perdre leurs caractéristiques.