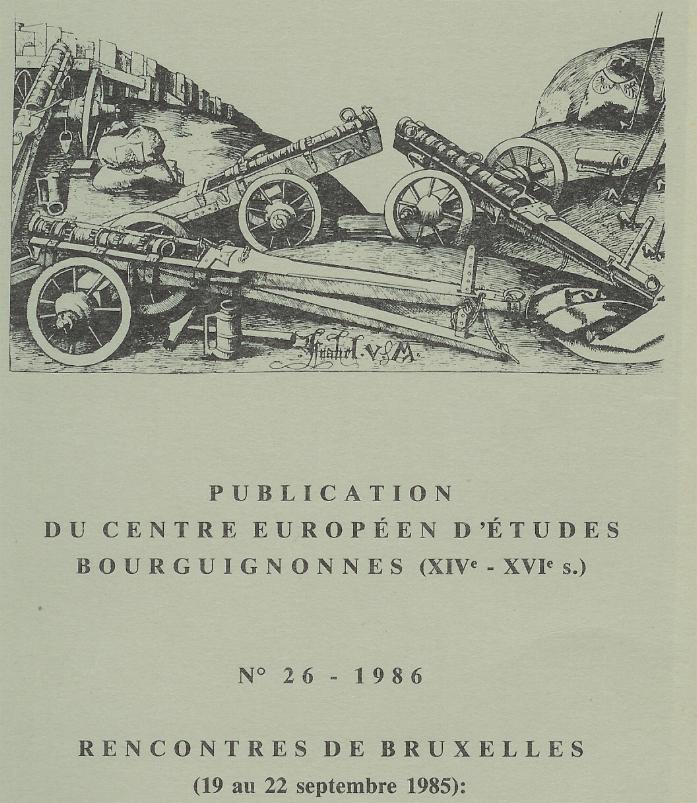
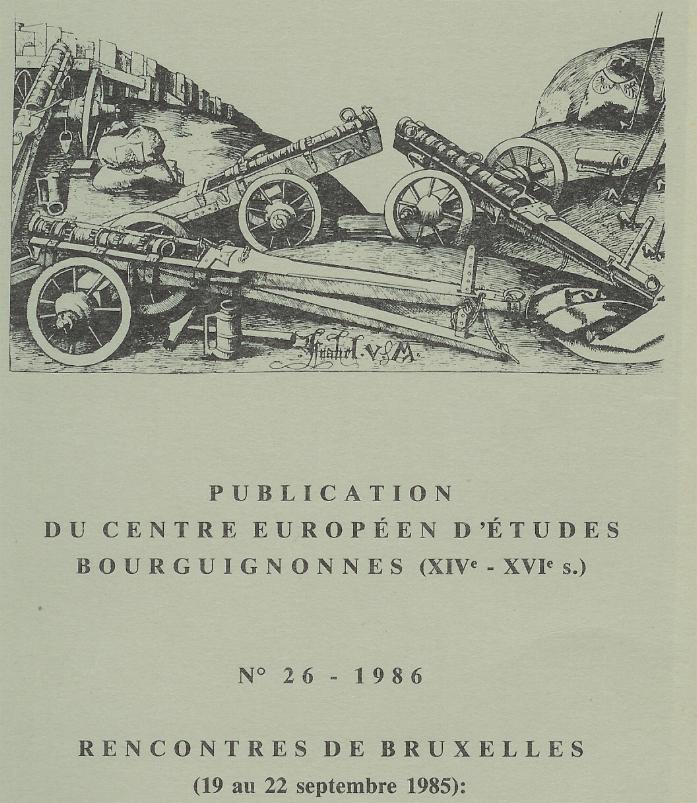
Extrait d’une publication du centre européen d’études
bourguignonnes N°26-1986
LOUIS-EDOUARD
ROULET Professeur aux Universités de Neuchâtel et Berne
Il
peut paraître présomptueux, voire prétentieux de traiter un sujet rebattu et
qui apparemment n'offre plus guère de secret. Si je prends la liberté de le
faire, c'est qu'il me semble indispensable non seulement d'analyser le déroulement
de la bataille de Morat en fonction de celle de Grandson, mais encore de situer
ces deux confrontations armées dans un contexte politique, diplomatique et économique
plus large. Ce qui m'importe plus particulièrement - mais dans l'optique que je
viens de décrire - c'est concernant le duc de Bourgogne lui-même, le
dispositif militaire décidé à Morat, les mesures prises, et surtout le
comportement de Charles pendant le combat.
Or
nul n'ignore que ce dernier a été jugé sévèrement par la postérité.
Pourquoi? Parce que la tentation est grande pour l'historien de reprendre et de
reproduire des opinions ou des jugements antérieurement émis et dont les
auteurs sont taxés-dignes de foi. Or, concernant l'attitude du Hardi à Morat,
deux contemporains de poids et de choix ont contribué, pour une partie en tout
cas, à forger et à former l'opinion critique: Commynes et Jean-Pierre
Panigarola.
On
pourrait qualifier Commynes, qui n'était pas sur place, de témoin de moralité.
Le chroniqueur, passé des services de Bourgogne à ceux de Louis XI, nous a
laissé du Téméraire vieillissant - pourtant il était bien jeune encore - un
portrait peu flatteur. Celui d'un prince devenu cruel, obnubilé par son propre
moi, différent de ses prédécesseurs, orgueilleux, en quelque sorte
responsable des malheurs de ses peuples. Et sur cette toile de fond s'ajoute, se
dessine, se plaque l'instantané enregistré par Pa,nigarola pendant le
combat, instantané d'autant plus impressionnant qu'il reflète la vision d'un
remarquable observateur doublé d'un bon écrivain - une espèce de précurseur
du reportage pris sur le vif - car l'ambassadeur du duc de Milan accompagne le
Hardi lors de ses expéditions militaires. Or que dit-il de la réaction de
Charles, au moment où, à Morat, les Confédérés attaquent?
«Et jamais je n'avais vu ledit Seigneur aussi éperdu
et ne sachant que faire qu'au moment où il s'arma et monta à cheval, lui qui
d'habitude est sagace, l’œil ouvert et sur ses gardes. Je vois là la volonté
divine: aut quod sic fata darent. »
39
postérité
n'a point retenu cette partie du discours. Elle est demeurée fascinée par
l'image d'un homme célèbre ayant perdu la maîtrise de soi, se contentant de
voir dans cette métamorphose, non point comme Panigarola un accident à la fois
subit et incompréhensible, au point qu'il en rend responsable la fatalité ou
la volonté divine, mais bien l'issue dramatique d'une évolution annoncée et décrite
par Commynes. Or notre propos sera de tenter de justifier, par une approche systématique
et logique, une suite d'événements jugés à la lumière diffuse de
l'irrationnel ou d'une sclérose de l'esprit.
Pour
comprendre le déroulement de la bataille de Morat, il faut d'abord connaître
le site, le décrire, le comparer à celui de Grandson, en évaluer l'importance
dans le réseau routier de l'époque. Or ce qui frappe, en premier lieu, c'est
le tracé Berne-Lausanne, seule liaison digne de ce nom, qui permet d'atteindre
d'Une part Genève et Lyon, d’autre part la Franche-Comté et Dijon. Parallèlement
à la route de Lausanne, celle qui mène à Bâle est pour Berne de valeur
essentielle puisqu'elle conduit, au
delà de la cité rhénane, à l'Alsace, à la Forêt Noire, aux pays du Rhin.
Or les routes de Lausanne et de Bâle se séparent ou se rejoignent à Morat.
Côté
bourguignon, la
vision est à la fois différente et complémentaire. le tracé Besançon-Pontarlier-Col
de Jougne-Lausanne-Grand-Saint-Berpard est d'importance dans la mesure où il mène
à Milan. De même la route Dole-Col de la Faucille-Genève et le
Petit-Saint-Bernard. D'où qu'on vienne, on rencontre toujours Yolande de
Savoie. Le contrôle de la baronnie de Vaud ne peut se faire que par le
truchement d'une alliance ou alors par la mainmise d'une conquête. Pour les
Bernois comme pour le Hardi.
L'examen
de la carte politique des cantons à la veille des guerres de Bourgogne apparaît
révélateur. Ils sont au nombre de huit, regroupés en faisceaux, allongés
sur l'axe du Gothard, entre Zurich et les lacs italiens d'une part, entre les
Alpes et le Jura de l'autre. A l'ouest des Ligues, la Bourgogne, au sud-ouest
la Savoie. Entre la Savoie et Berne, Fribourg dépendant de la première mais
jouant, non sans risque, la carte politique et militaire de la ville de l'Aar
parce que désireuse de s'affranchir d'une tutelle contraire au désir d'émancipation.
Enfin, entre la Confédération et la Bourgogne, le petit pays de Neuchâtel
dont la position apparaît précaire, tant au plan stratégique qu'au plan
diplomatique puisque le comte Rodolphe de Hochberg est à la fois combourgeois
de Berne et vassal du Hardi pour ses fiefs d'outre-Jura. On sait qu'il tentera
de réconcilier les adversaires, au cours de négociations qui se tinrent à
l'année 1475, mais qui n'aboutirent point, ce qui l'engagea, en désespoir de
cause, à miser sur les deux tableaux, donc à se réfugier à Berne en laissant
son fils Philippe chevaucher aux côtés du Grand Duc d'Occident.
40
La
ville de l'Aar, dont Charles voulait s'emparer, était protégée, en profondeur,
par trois verrous, situés sur les axes de pénétration et occupés par des
garnisons suisses. À l'ouest, Grandson, fief des Chalon de Bourgogne, sur la
route de Neuchâtel, voie de pénétration secondaire certes, mais utilisable
par une armée en marche désireuse d'atteindre son objectif après avoir longé
le pied du Jura, puis par Aarberg franchi le Seeland. Au centre du dispositif,
Morat, relevant de l'autorité de Jacques de Romont, baron de Vaud, vassal de la
Savoie, petite ville fortifiée contrôlant la route principale de Berne, par
la large vallée de la Broye. À l'est, Fribourg, en rébellion contre son
suzerain, située sur la seconde route principale de la ville de l'Aar, le
long de l'étroite vallée de la Sarine.
Il
convient d'accompagner le Hardi lorsque, venant de Pontarlier, en janvier 1476,
il franchit le col de Jougne puis, à la tête de son armée, pénètre dans le
pays de Vaud, donc en Savoie. A Orbe, il bifurque en direction du nord,
s'engageant le long de la route du pied du Jura. Son intention? À coup sûr
s'emparer de Grandson, fief des Chalon de Bourgogne, indûment occupé par les
Confédérés. Sans doute de pousser plus loin, une fois cette première ville
prise, en direction de Neuchâtel, qui relève de l'autorité de Rodolphe de
Hochberg, son vassal, enfin, en partant de là, d'attaquer Berne, l'ennemi. En
première urgence donc, neutraliser Grandson. Le Hardi installe un camp fortifié
sur l'Arnon, au nord de la cité, pour empêcher l'arrivée de renforts, isole
ainsi la ville, pousse son exploration jusqu'au château de Vaumarcus, à la
limite même du comté de Neuchâtel. Puis commence le siège, au cours duquel
l'artillerie bourguignonne, arme mal connue des Suisses, sème la désolation et
l'effroi. Le duc s'empare de la cité, du château, se montre sans pitié envers
les hommes de la garnison. Il est vrai que les Confédérés avaient agi de même,
quelques mois plus tôt, envers les défenseurs d'Estavayer-le-Lac, à peu de
distance de là.
La
suite des événements est dictée au duc pour une part par sa volonté de
poursuivre sa progression, puisque le premier verrou a sauté, mais aussi par
les nouvelles de l'ennemi que lui transmet son renseignement. Or, il a appris
que les Suisses se rassemblent dans le comté de Neuchâtel et que tôt ou tard
il se heurtera à eux.
Tout
chef militaire qui doit en découdre avec l'adversaire souhaite choisir le
terrain où il pourra imposer sa manœuvre. La chute de Grandson est certes une
excellente affaire, mais se battre à proximité de la ville n'offre point de
perspective réjouissante. Pour celui qui, comme Charles, regarde au nord, il y
le lac à sa droite, le Jura, donc la montagne à sa gauche. Deux routes, l'une
le long du rivage, ou presque, l'autre, à mi-hauteur, partiellement boisée,
l'ancienne voie romaine, la «vy d'Etra» (via strata). Le duc décide
d'explorer en force par la route du haut et le 1er mars se porte en avant avec
le gros de ses troupes. En effet, se sentant à l'étroit, entre la montagne et
le lac, il veut gagner la plaine de Concise, à six ou sept km. au nord, c'est-à-dire
un lieu où le Jura s'éloigne, ce qui doit lui permettre de déployer mieux son
armée. Au moment où il s'installe - nous sommes le 2 mars -, son exploration
lui annonce une attaque imminente des Suisses venus par la voie romaine, donc
par la route du haut. Et très vite surgissent les Confédérés, en fait une
forte avant-garde de quelques
42
milliers d'hommes. La mêlée qui s'engage apparaît un
peu confuse, indécise, à l'issue incertaine. Ce qui engage le Hardi à
prendre une décision lourde de conséquence: faire reculer ses gens d'armes,
attirer les Suisses entièrement dans la plaine, les encercler, puis les anéantir,
avec les archers anglais à gauche, l'artillerie au centre et la cavalerie
lourde à droite.
Or,
au moment où s'opère la manœuvre, le gros de la force confédérée surgit le
long de la route du lac pour immédiatement se jeter à l'assaut. On connaît la
suite: surprise, désordre, panique, fuite des Bourguignons qui perdent leur
artillerie, une grande partie de leur camp, mais relativement peu d'hommes.
Quelle
est la leçon que Charles tire de Grandson? Elle s'articule en trois points.
D'abord il apparaît que les Suisses ont remporté la victoire grâce à un
concours de circonstances partiellement imprévisibles. Mais ils ne sont pas
invincibles. Le témoignage de Panigarola demeure formel: ils étaient fatigués.
On aurait pu les battre. A cette certitude s'ajoute, aux yeux du duc, une deuxième
évidence. En raison de leur meilleure connaissance du terrain, les Confédérés
ont réussi une feinte. En faisant semblant de porter leur effort principal
par le haut, alors que le gros de leurs forces attaquaient par le bas, ils ont
donné le change et trompé l'adversaire. Enfin troisième constatation: il
demeure risqué d'abandonner un camp fortifié pour se porter en avant, dans une
position qui ne peut être suffisamment aménagée à l'avance, lorsqu'on connaît
malles lieux où l'on progresse.
On
sait que ce qui est. sans doute apparu comme une feinte au duc, côté suisse l'était
beaucoup moins dans la mesure où la double progression, à mi-hauteur et par le
bas, suivie du double assaut était due beaucoup plus à l'arrivée échelonnée
des contingents cantonaux et à l'impétuosité des combattants qu'à l'exécution
d'une manœuvre sciemment conçue. Peu importe, en l'occurrence. Pour le Hardi
seule la réalité de l'affrontement a compté. Or cette réalité s'est bien
manifestée sous forme de deux attaques, la première par le haut, la seconde
par le bas. Diebold Schilling, dans sa belle chronique illustrée des Guerres de
Bourgogne, le montre de manière irréfutable.
Abandonnons
Grandson et rejoignons Charles à Lausanne, où il a installé son nouveau
camp, après avoir séjourné quelque temps à Nozeroy, en Franche-Comté,
suffisamment longtemps pour se rendre compte que les Confédérés ne le
poursuivaient pas, qu'ils renonçaient à occuper le pays de Vaud, où il
convenait de se rendre sans retard, en vue de s'assurer le concours quelque peu
chancelant de la duchesse Yolande de Savoie. Le regroupement de l'armée se fait
selon un dispositif bien connu qu'on se bornera à rappeler dans la mesure où
sa mise en place sera déterminante lors de la bataille de Morat.
1. Les forces dont dispose le duc sont regroupées en quatre corps de
chacun
deux divisions. S'ajoute aux quatre corps la réserve.
2. Les corps sont respectivement aux ordres du duc
d'Attry, du prince de Tarente, qui d'ailleurs quittera Charles à la veille de
Morat, du comte de MarIe, du comte de Romont. La réserve relève du maréchal
des logis.
44
3. Chaque corps est composé d'hommes d'armes,
d'archers, de gens à
4. Les Anglais et les Lombards qui s'entendent fort
mal- on connaît les rixes sanglantes survenues au camp de Lausanne - ne sont
jamais regroupés dans le même corps.
Que
vaut le moral de la troupe? À en croire Panigarola, il laisse à désirer.
Retard dans le paiement de la solde, dans l'acheminement des renforts
d'artillerie. Rivalité et jalousie entre corps de troupes. Indiscipline. Mais
l'autorité du duc finit par s'imposer. Au moment du départ de Lausanne, le
Hardi a repris ses hommes en main. Le meilleur corps est sans doute celui de
Jacques de Romont, le 4e parce qu'il comprend une troupe d'élite, celle
d'Antoine d'Orlier, qu'il est renforcé par la meilleure cavalerie
bourguignonne, celle du sire de NeufchâteI-BIamont et surtout parce qu'il
s'agit de combattants motivés, comme on dit aujourd'hui, pour la bonne raison
qu'ils ne portent point dans leur cœur les Confédérés, qui ont par deux fois
dévasté le pays de Vaud. Solide aussi le 3e corps du comte de MarIe, fortement
encadré par la chevalerie et la garde ducale du 1er corps. Moins sûrs les
Lombards du prince de Tarente et la réserve aux ordres du Grand Bâtard
Antoine.
Le
27 mai 1476, à la tête de son armée reconstituée, Charles quitte Lausanne.
Trois routes s'offrent à lui. Celle d'Orbe-Yverdon-Grandson, connue parce que
déjà prise. Il y renonce. Sans doute parce qu'elle n'est pas la meilleure et
parce que pour atteindre Berne, passer par Neuchâtel représente un détour
important. Peut-être aussi parce que superstitieux, il ne veut pas retourner
sur les lieux d'une première défaite. Les deux autres itinéraires qui se
dessinent sont, soit la vallée de la Broye avec le verrou de Morat, soit la
vallée de la Sarine, avec l'obstacle de Fribourg, ville également fortifiée
et tenue par les Suisses. La vallée de la Broye apparaît beaucoup plus
large, donc propice au déploiement des troupes, elle permet de mieux se
garantir contre d'éventuelles attaques surprises. Et puis Morat étant fief de
Jacques de Romont, l'espoir d'une reconquête, d'une reprise par les Savoyards
ne peut que stimuler l'ardeur des combattants. Aussi le Hardi choisit-il cette
route, en s'y engageant avec une prudence extrême. Douze jours, en trois étapes,
avec chaque fois des camps retranchés pour franchir les quelque soixante kilomètres
qui séparent Lausanne de Morat. Le 9 juin, le Grand Duc d'Occident arrive enfin
à portée de boulet de la petite cité, défendue par une très forte garnison
d'environ 2000 hommes, aux ordres d'Adrien de Bubenberg, ancien avoyer bernois,
et par l'artillerie bourguignonne, prise à Grandson, installée sur les
remparts, commandée par quatre maîtres italiens, les Confédérés
connaissant fort mal cette arme redoutable. Le fait que Bubenberg ait parfait
son éducation chevaleresque à la cour de Bourgogne, où il s'est pris
d'amitié pour Charles, donne à la confrontation qui va les opposer un arrière-goût
de tragédie antique.
Tout
dispositif miliaire est déterminé par le but que l'on poursuit, les moyens
dont on dispose, le terrain qui s'offre à vous et l'image que l'on se fait de
l'ennemi. La volonté première et dernière du Hardi est de s'emparer de
Morat, donc de faire sauter le verrou, puis, ses arrières étant assurés,
45
de marcher sur Berne. Concernant la nature du terrain,
une extraordinaire analogie se dessine entre Grandson et Morat. Dans les deux
cas un lac, avec à son bord, une cité fortifiée, tenue par l'ennemi. Dans les
deux cas, jouxtant le lac, une plaine d'environ 1 km de large, puis se
transformant en une pente relativement douce au départ, pour peu à peu épouser
la montagne. Dans les deux cas, une route du haut et une route du bas. La seule
différence apparaît dans l'inversion du relief topographique. Pour les
Bourguignons, à Grandson, la ville et le lac étaient à droite, le Jura à
gauche. À Morat, la cité, dont il faut s'emparer, se situe à gauche, les
hauteurs à droite.
Les
décisions que Charles prend à Morat témoignent d'un sens tactique évident et
d'une volonté indéniable de tirer profit de l'expérience de Grandson.
L'analogie de la configuration topographique en quelque sorte l'y oblige. Il espère,
bien sûr, s'emparer de la ville avant l'arrivée des Confédérés. Mais il
n'en est pas absolument sûr, car, selon toute probabilité, du moins à ses
yeux, les Suisses, pour éviter aux défenseurs de Morat de connaître le même
sort que celui subi par ceux de Grandson, tenteront de porter secours à la
garnison assiégée. Pour débloquer la cité, ils seront donc tentés de
concentrer leur effort principal par la route du bas, comme ils l'ont fait à
Grandson, il est vrai trop tard pour sauver la citadelle. Mais cet effort
principal par la route du bas n'exclut pas, comme à Grandson, une feinte, donc
une surprise, en d'autres termes une progression, voire un assaut d'une
avant-garde, par la route du haut.
À
la fin du moyen âge - est-il besoin de le rappeler - les différents ordres de
mission donnés aux chefs de troupes ne s'exprimaient point par le langage des
militaires d'aujourd'hui. Il n'est cependant pas téméraire, au vu de
l'occupation du terrain par l'armée du Hardi, de préciser le rôle dévolu à
chaque corps, au sein du dispositif général. On pourrait résumer de la manière
que voici:
1.
Lui-même s'installe au haut d'une éminence, en forme de cône, le Grand-Bois
Domingue, d'où il domine l'ensemble et exerce une vue plongeante sur Morat.
2.
Autour de lui, son quartier-général renforcé par le 1er corps du duc d'Atry,
avec pour mission de le protéger, mais pouvant être engagé, soit à gauche en
appui au comte de Romont, soit à droite en faveur du comte de MarIe.
3.
Le comte de Romont avec son 4e corps, le meilleur, au nord de Morat. Mission
première: empêcher la jonction, par la route du lac, de la garnison assiégée
et des Suisses venus à son secours. Mission secondaire: aider le corps du
prince de Tarente, le 2e, implanté au sud de la ville, à prendre celle-ci .
4.
Le 2e corps, situé dans la région de Meyriez, donc au sud de Morat, a pour
seule mission de s'emparer de la ville.
5.
Le 3e corps du comte de MarIe est placé au nord du Grand-Bois Domingue, donc
face à l'ennemi. Mission première: surveiller et contrôler la route du haut
et s'opposer à tout assaut venu de là. Pour ce faire, Marie fait édifier à 1
à 2 kilomètres de la lisière de la forêt, une fortification de campagne, la
fameuse haie verte. Elle s'appuie sur les archers anglais, de
47
l'artillerie et une réserve de cavalerie, en tout
peut-être deux mille hommes. À gauche de la haie verte, un fossé naturel
profond, à droite un terrain marécageux.
Pour
celui qui prend la peine d'étudier attentivement le dispositif de Charles à
Morat, l'évidence saute aux yeux. Sans doute le duc demeure-t-il convaincu
que ses adversaires attaqueront par la route du bas puisqu'il leur prête
l'intention première de vouloir dégager Morat. Deux autres raisons militent
en faveur de cette manœuvre. Une attaque par le haut obligerait les
assaillants à demeurer à découvert sur une distance relativement longue,
s'offrant ainsi en cibles aux défenseurs de la haie verte. Par ailleurs,
l'exemple de Grandson aidant, les Suisses seront tentés de répéter le
mouvement pour répéter la victoire. Or, c'est précisément cette analogie
du relief topographique qui apparaît à l'origine de l'édification de la haie
verte. Comme à Grandson, l'ennemi pourra faire diversion par le haut, donc une
fois encore donner le change, en vue de masquer l'assaut principal qui
s;effectuera par le bas. Mais la vraie bataille se déroulera par le bas, au
nord de Morat, en vue de dégager la ville. Le duc en est convaincu. Pour le
comprendre, il suffit d'évaluer dans chaque cas l'importance du second échelon,
du renfort. Marie, sur les hauteurs, derrière sa haie verte, ne peut être
appuyé à court terme que par d'Atry et le corps du Bois Domingue, alors que
Romont qui, au nord de Morat, subira le choc principal, pourra bénéficier du
soutien des quatre autre corps qui se rabattront en éventail.
Quelle
que soit l'évidence d'une démonstration, elle ne suffit pas à reconstituer,
à coup sûr, la vérité historique, si elle se contente de se référer à la
logique et à la topographie. Il faut le document irréfutable. Or voyons ce qu'écrit
Panigarola. Et d'abord concernant le siège de la cité investie, qui - on l'a
vu - incombe en premier lieu au 2e, subsidiairement au 4e corps de troupes. Ici
les choses traînent, en raison surtout des pièces d'artillerie installées
sur les remparts et qui empêchent la progression des assaillants.
Heureusement pour le Hardi, les Confédérés, dont le but est de dégager Morat
d'une étreinte qui pourrait se révéler mortelle, sont encore bien loin. Le 12
juin, le duc a poussé une forte reconnaissance sur les têtes de pont de la
Sarine, à Laupen et à Gümmenen, sans rien trouver devant lui. Mais le temps
presse. Ce même soir du 12 juin, Charles, pour s'emparer de Morat, ordonne un
premier assaut coordonné et généralisé, côté sud les Lombards du 2e corps,
côté nord les Savoyards de Jacques de Ramant. Ces derniers, après avoir creusé
des tranchées, parviennent jusqu'à proximité des murailles. Le lendemain
matin, pris sous le feu violent des défenseurs, ils tiennent bon, alors que
les Lombards refluent. Appréciant cette situation, Charles prend une décision
capitale. Du moment que les Suisses sont encore éloignés, c'est Ramant qui,
avant leur approche, donc avant la bataille, prendra la ville. Dans la nuit du
14 au 15 juin s'opère, côté savoyard, donc au nord de la cité, un changement
du dispositif d'assaut, par la mise en place de la lourde artillerie de siège.
Véritable exploit, dans l'obscurité, on transporte deux bombardes, plusieurs
courtaux et de grandes couleuvrines, certaines pièces pesant plusieurs
tonnes. On les monte sur des poutres, on les enterre, et dès l'instant où l'on
a réussi à se rapprocher
de deux à trois cents mètres des remparts, on les
protège au moyen de gabions, de parapets de terre et de boucliers. Dès le
samedi 15 juin, le bombardement commence. Il sera meurtrier et surtout dévastateur.
Une partie du mur d'enceinte de la ville s'écroule, la tour dite de la Poudrière
s'effondre, celle dite des Chaudronniers est sérieusement touchée.
Pour
tenter de parer à une menace qui ne cesse de s'affirmer, Bubenberg ordonne
une sortie, dans le but de neutraliser l'artillerie de siège. Quelque 70 défenseurs
se ruent au dehors, parviennent jusqu'aux premières pièces, se mesurent aux
servants, en blessent quelques-uns, mais étant trop peu nombreux, sont repoussés
à l'intérieur. L'opération de dégagement n'a pas réussi. Pis, accident
apparemment sans importance, mais dont les conséquences seront déterminantes,
un homme de la garnison est prisonnier des Bourguignons. Parce que celle-ci,
nuitamment et par le lac, est restée en communication avec l'armée suisse de
secours, il peut révéler au Hardi l'intention de manœuvre de l'ennemi. Dans
la nuit du 17 au 18 juin, donc la nuit suivante, l'attaque des Confédérés se
fera en deux points du camp, mais avec l'effort principal en direction de Morat,
en vue de dégager la garnison qui, de son côté, tentera une sortie massive
pour rendre possible la jonction. Car c'est bien d'une opération de dégagement
qu'il s'agit. L'homme capturé est formel. Si elle réussit, les Suisses se
retireront, ils se sentent trop faibles et trop peu nombreux. Ces
renseignements, écrit Panigarola, confirmaient ceux que le duc avait obtenus
par une autre voie. Laquelle? L'extrême discrétion de l'ambassadeur milanais
nous incite à supposer qu'il pourrait s'agir de l'astrologue bernois, on le
sait soudoyé par Charles, et qui semble l'avoir informé à plus d'une reprise,
notamment en lui faisant savoir plus tard que la grande bataille serait livrée
le 21 juin.
Pour
l'instant et dans l'immédiat, donc le 17 au soir, le duc ne met point en doute
la valeur du renseignement qui vient de lui être donné. D'autant moins qu'il
confirme la perspicacité de sa propre appréciation et le bienfondé de son
dispositif. Il faut demeurer sur ses gardes, à droite, sur les hauteurs, derrière
la haie verte, où peut se dessiner, s'esquisser une attaque de diversion,
sans pour autant tomber dans le piège d'une feinte,
, comme à
Grandson. L'essentiel demeure d'être prêt à se porter à gauche, en vue
d'appuyer Romont et d'empêcher la réunion entre la garnison et l'armée de
secours. Le duc alerte immédiatement ses troupes, ordonne le branle-bas,
demeure à cheval toute la nuit. Dès l'aube, et ne voyant rien venir, il pousse
des reconnaissances, galope en personne au-delà de ses avant-postes, et, en
raison de l'absence de l'ennemi, à huit heures du matin, renvoie ses hommes
dans leurs quartiers. L'alarme, même si elle n'a pas été suivie du combat, ne
s'est pas révélée inutile. Elle a permis de déceler le point faible du
dispositif bourguignon. Ce n'est pas à droite, sur les hauteurs - où
d'ailleurs rien ne s'est passé - et où le camp est protégé par la haie
verte, et où ne peut se produire qu'une opération secondaire, mais bien à
gauche, côté Morat. Lorsque l'armée bourguignonne se portera en avant pour
appuyer Romont, au contact des Suisses, son flanc gauche sera soumis au feu des
défenseurs de la ville. D'où la décision du Hardi de réduire la menace. Le
18 juin, donc le même jour, à six heures du soir,
49
après un bombardement intense qui a duré toute la
journée, les hommes de Romont donnent l'assaut. Ils progressent jusqu'à
l'enceinte, franchissent la brèche, escaladent les créneaux, et dans un
corps-à-corps furieux, qui dure près de quatre heures, se mesurent aux défenseurs
acculés dans leurs derniers retranchements. Finalement l'assaillant est repoussé.
Journée meurtrière, écrit Panigarola; elle l'est aussi pour la garnison. Côté
bourguignon quelque soixante morts et une centaine de blessés. Mortifié par
l'échec subi, le Hardi admoneste ses capitaines. Pourquoi, répliquent ceux-ci,
sacrifier nos meilleurs hommes alors que nous devons les maintenir intacts pour
affronter les Suisses regroupés dans l'armée de secours? Déclaration
importante qui confirme une nouvelle fois deux hypothèses, à savoir que les
Savoyards de Romont constituent bien un corps d'élite, et puis que c'est bien
ce corps d'élite qui est destiné à subir le choc principal de l'ennemi.
D'ailleurs le duc, beaucoup moins obstiné que ne le prétend la postérité,
admet la pertinence de cette réserve. Elle l'incite même à modifier son
dispositif et à revenir à ses intentions premières. C'est à nouveau le 2e
corps qui, côté sud, s'emparera de Morat, et pour ce faire se voit attribuer
ou rendre une artillerie renforcée. Romont, lui, ne s'occupera plus de la
ville. Il se contentera, en attendant l'ennemi en face, de protéger ses arrières,
par l'établissement de fortifications de campagne, pour éviter que la garnison
ne tente et ne réussisse une sortie dans son dos.
En
ordonnant l'assaut du 18 juin au soir, le duc poursuivait deux buts. En premier
lieu, s'emparer de la ville, pour le moins de sa partie nord, afin d'annihiler
le feu adverse susceptible de porter préjudice à son flanc gauche, mais aussi
d'obliger les Confédérés retranchés derrière la Sarine, alertés par le
bruit du canon, à se porter en avant pour dégager Morat. Car le Hardi
ne veut d'aucune manière retarder l'affrontement. Il souhaite, au contraire,
qu'il se fasse sans retard pour maintenir élevé le moral de ses troupes et
parce que l'ennemi se renforce de jour en jour. Si le premier objectif, la chute
de la ville, ne sera pas atteint, le second, donc la mise en branle de l'armée
confédérée, le sera pleinement. Le 18, les Suisses lèvent leur camp de Gümmenen,
franchissent la Sarine pour se porter en avant. Mais, ayant appris que Morat
n'est pas tombé, ils s'arrêtent à Ulmiz, dans l'attente de renforts. Le jeudi
20 juin, ils prennent deux décisions essentielles: la première est d'engager
le combat le lendemain 21 juin, la seconde de modifier la direction de
l'attaque, en laissant le bas au profit du haut. Psychologiquement et
tactiquement, cette dernière mesure apparaît pour le moins critiquable. Parce
qu'elle abandonne dans l'immédiat la garnison de Morat à son sott, et
surtout parce qu'en passant par le haut, il faudra franchir, sous le feu
adverse, un glacis découvert de plus d'un kilomètre avant de se heurter à la
haie verte, seule défense vraiment fortifiée du camp bourguignon. Mais
le critère qui détermine la modification intervenue est sans doute beaucoup
moins militaire que politique. Lorsqu'on évoque la bataille qui va être livrée,
il ne faut pas oublier de la situer dans un contexte plus général.
Les communications présentées au colloque scientifique de 1976, à
Morat, à
l'occasion du 5e centenaire, ont permis de préciser un certain nombre de
points qui peut-être avaient été négligés. Notamment combien Berne
50
regrettait la rupture avec la Savoie, maîtresse du réseau
routier conduisant à Genève, et de là à Lyon. Le vrai demeure que la ville
de l'Aar n'attendait qu'un geste pour renouer. Quel geste? Celui que Yolande a
fait déjà, ou va faire en abandonnant Charles, ce qui d'ailleurs provoquera,
le 23 juin, donc un jour seulement après l'affrontement, l'importante entrevue
de Gex, puis plus tard, l'enlèvement des deux enfants de Savoie sur ordre du
Hardi. La rupture de l'alliance, d'ailleurs largement imposée à la duchesse,
était prévue, certainement préparée. Romont, beau-frère et vassal de
Yolande, a sans doute été informé. Est-ce lui qui le premier a pris contact
avec les Confédérés? Nous ne le savons pas. D'Appiano, ambassadeur du duc
de Milan auprès de la duchesse de Savoie, fait savoir à son maître qu'un
courrier du roi de France, parti avant la bataille, était porteur d'un
message destiné aux Suisses, les incitant à ne rien entreprendre, ni contre
Yolande, ni d'ailleurs contre Charles.
Si
les négociations qui entourent la rupture entre la Savoie et la Bourgogne
demeurent aujourd'hui encore partiellement inconnues, - on peut imaginer qu'en
raison de l'importance du secret à conserver, elles n'ont pas toutes laissé
des traces -, les différentes phases de l'affrontement apparaissent révélatrices.
Mais avant de les rappeler, une question s'impose: le duc de Bourgogne s'est-il,
avant le combat, méfié de quelque chose? Il ne semble pas. Lorsque le 22 juin,
jour de la bataille, les nouvelles annonçant une attaque imminente des
Suisses par le haut se multiplient, il répond qu'il s'agit de faux-bruits
propagés par des traîtres au service du roi de France. Ce n'est que lorsque le
Grand Bâtard, son propre frère, le conjure d'y voir clair, qu'il consent à
engager l'armée en appui des défenseurs de la haie verte, beaucoup trop tard,
en position inconfortable parce que dans un échelonnement en montée. Jusqu'au
bout, Charles demeure convaincu que l'assaut donné par le haut, comme à
Grandson, ne traduit qu'une opération secondaire, que l'effort principal des
Confédérés visera à dégager Morat, par le bas.
Il
demeure facile après coup d'accuser le duc d'avoir apporté la preuve d'un entêtement
maladif, comme d'affirmer que son service de renseignement fut médiocre.
Lorsqu'on regroupe toutes les informations parvenues au Hardi jusqu'à l'aube du
22 juin, on peut aisément affirmer le contraire. Il apparaît pour le moins
probable que les Confédérés avaient pour première intention de dégager
Morat, en attaquant par le bas,. comme d'ailleurs l'a confirmé l'homme de la
garnison fait prisonnier par les Bourguignons. Charles, après l'avoir
pressenti, était donc au courant. La bataille devait être livrée le vendredi
21 juin. Le duc ne l'ignore pas. Ce qu'il ne peut prévoir, en revanche, c'est
que l'assaut, le seul, l'irrésistible sera donné par le haut, contre la haie
verte et que - comble de malheur - cet assaut meurtrier et funeste pour les
Bourguignons n'aura lieu que le samedi 22, avec un jour de retard.
Que
s'est-il passé? Le vendredi 21, toute l'armée du Hardi est sur pied, en
position et en articulation de combat, dans l'attente d'un ennemi qui doit dégager
Morat, donc d'une rencontre par le bas. Mais les Suisses n'apparaissent pas. Le
soir, le duc pousse lui-même une reconnaissance, au-delà de ses avant-postes,
jusqu'à proximité du village d'Ulmiz. «Nous
51
vîmes», écrit Panigarola, «une troupe peu
nombreuse, en contrebas. Elle nous gratifia de quelques coups d'escopette».
Persuadé qu'il ne peut s'agir que de l'avant-garde d'une armée en marche en
direction de Morat, donc convaincu que les Suisses demeurent encore de l'autre côté
de la Sarine, Charles regagne son camp et renvoie ses hommes dans leurs
quartiers. Il est grand temps qu'ils prennent quelque repos.
Côté
suisse - on l'a dit déjà -les événements se sont précipités. Modifiant
leur plan initial, les capitaines, vraisemblablement pour ménager Romont, ont décidé
d'évacuer Ulmiz, de concentrer leurs contingents, plus au sud, dans la forêt
et la clairière de Lurtigen, en vue d'attaquer par le haut. Ce que le duc a
pris pour l'avant-garde d'une armée venue délivrer Morat n'est plus que l'arrière-garde
d'un gros qui a déjà changé de direction. Et puis, au dernier moment, la décision
a été prise de renvoyer l'affrontement du 21 au samedi 22 juin. Pourquoi?
Parce que, bonne nouvelle, on a appris que les Zurichois, forts de plusieurs
milliers d'hommes, étaient sur le point d'arriver et que les cavaliers du duc
René de Lorraine, comme ceux du comte de Thierstein, étaient en marche. Mais
il convient de réfuter une affirmation trop longtemps avancée. Ce n'est pas
parce que l'assaillant disposait de cavalerie qu'il a décidé d'attaquer par le
haut. En revanche, ce qui demeure indéniable, c'est que la présence et
l'engagement de celle-ci a largement favorisé la réussite d'une opération qui
initialement demeurait risquée.
Le
déroulement de la bataille est trop connu pour qu'il soit utile de le rappeler
ici. On sait que la haie verte n'a pas résisté à l'assaut de l'ennemi et que
les Confédérés et leurs alliés, plus de vingt mille hommes, progressant du
haut vers le bas, ont écrasé l'armée adverse alertée beaucoup trop tard,
surprise par la direction de l'attaque, et, là où elle s'est opposée par les
armes, ne pouvant le faire que de manière sporadique, donc sans coordination
aucune.
Que
devient Romont dans cette sanglante mêlée qui, à en croire Panigarola, n'a
pas duré plus qu'un miserere? Non seulement il n'est pas importuné par la
garnison de Morat qui effectue une sortie en règle, mais côtésud seulement,
non seulement il n'appuie d'aucune manière l'effort du vieux chef lombard
Troylo, placé devant lui, et qui tente de contre-attaquer les Suisses dévalant
la pente, sur leur flanc droit, mais il rassemble ses hommes, et sans être
inquiété, dans le dos de l'ennemi d'hier, de l'allié de demain, sans coup férir,
ramène dans le pays de Vaud son corps d'armée sain et sauf. Les historiens ont
admiré la manœuvre militaire. C'est la connivence politique qui mérite de
retenir l'attention.
Les
combattants suisses se sont-ils tous rendu compte qu'en passant par le haut, ils
ménageaient les Savoyards? Plus ou moins confusément. Les capitaines
lucernois, par exemple, rapportent qu'ils auraient pu en découdre avec
Romont, mais que celui-ci s'est esquivé alors qu'on se battait contre les
Bourguignons.. Jean de Kageneck, à sa manière, s'étonne quelque peu. Non
seulement Romont a levé son camp et a disparu avec quelque sept mille hommes,
à pied et à cheval, en direction de son pays, mais il a démonté ses pièces
d'artillerie - sans doute encore braquées partiellement contre Morat - pour les
emporter avec lui. L'opération, on s'en doute, doit avoir
53
duré plus que le temps d'un miserere. Quant à une
possible poursuite, à en croire un cavalier autrichien, poursuite qui devait
incomber au comte Oswald de Thierstein, est-il besoin de préciser qu'elle n'a
laissé aucune trace documentaire, donc que vraisemblablement elle n'a jamais eu
lieu? Ne s'en étonnera que celui qui oublie que huit jours après
l'affrontement de Morat, et en dépit d'expéditions d'ailleurs mal contrôlées
dans le pays de Vaud, nouvel exemple de l'indiscipline des contingents ou des
premiers corps francs confédérés de cette époque, l'armistice sera signé
avec la Savoie, puis le 15 août déjà la paix, enfin quelques mois plus tard
seulement une nouvelle alliance.
Voulant
expliquer la défaite du Grand Duc d'Occident, - défaite qui a frappé et les
contemporains et la postérité -, on a évoqué différents arguments. La
combativité insuffisante des troupes, un dispositif pour le moins sujet à
caution, le tragique entêtement du duc, la fausse alerte du 21 juin, la pluie
du 22. Mais les Suisses ont également été éprouvés par les orages
successifs qui se sont abattus le vendredi et le samedi matin. Après leur
marche forcée, en tout cas pour les Zurichois, ils étaient plus fatigués que
leurs adversaires. Quant à la mise en place de l'armée bourguignonne, elle témoigne
d'un esprit lucide, du souvenir de Grandson et, somme toute, d'une assez bonne
appréciation de la situation offerte. Reste le renvoi de la bataille du 21 au
22 juin que le Hardi ne pouvait prévoir. Reste aussi l'entêtement indéniable.
Le désarroi de Charles signalé par Panigarola, et pour lui incompréhensible,
n'est dû ni à la volonté divine, ni au destin. II s'explique par une évidence.
Jusqu'au dernier moment, le duc est demeuré convaincu qu'il avait raison, que
ses capitaines se trompaient, que l'attaque principale se ferait par le bas. II
est vrai que jusqu'à l'aube du jour fatidique, tous les renseignements
concouraient à faire de cette hypothèse presque une certitude.
On
peut et on doit le dire: contrairement à une opinion généralement admise, le
Hardi jusqu'au début de la bataille de Morat n'a pas démérité. II est demeuré
fidèle à lui-même, à sa réputation, apportant les preuves de son courage,
de son esprit d'entreprise, de sa faculté de tirer profit d'un échec, et dans
une certaine mesure de son ingéniosité. Le vrai est qu'avant de perdre
l'affrontement militaire, il a été vaincu au plan diplomatique. II a mal jugé
des relations entre les Confédérés et la Savoie. II a mal mesuré
l'importance pour Berne de la route de Genève. II s'est méfié de Louis XI,
voire de la duchesse Yolande, apparemment jamais de Jacques de Romont.
La
tentation existe de poursuivre le raisonnement et d'imaginer ce qui aurait pu se
passer si différents éléments - qui ont été profitables aux Suisses -
avaient joué en faveur du Grand Duc d'Occident. Donc si Romont n'avait pas été
ménagé, si les Confédérés avaient attaqué par le bas et surtout si le
combat s'était déroulé le 21 juin, comme prévu, et non le samedi 22.
Questions importunes, au fond superflues et surtout inutiles pour celui qui
refuse de tomber dans le piège d'une interprétation hypothétique de
l'histoire. Une certitude toutefois. L'issue de la bataille de Morat, dans sa
tragique ampleur pour les Bourguignons, est due aussi, et peut-être
essentiellement, à la redoutable force de frappe d'une masse d'infanterie
d'essence populaire, celle des Confédérés de ce temps. Preuve
54
en soit l'histoire militaire de l'époque. Pour les
cantons, elle n'enregistre, pendant deux générations, des guerres de Bourgogne
à Marignan, en 1515, que des victoires, contre le Hardi, l'empereur, les
princes italiens ou le roi de France. Mais cela, le soir du 21 juin 1476, ni
Charles, ni les Suisses eux-mêmes, ne pouvaient le savoir.
BIBLIOGRAPHIE
1.
Sources imprimées
Amtliche
Sammlung der a/ten Eidgenossischen Abschiede, Bd
2, Luzern,1863.
Ph. de
COMMYNES, Mémoires. Ed. par CALMETTE, Joseph, Paris, 1924-1925.
G. GROSJEAN, Der Kupferstich Martinis über
die Schlacht bei Murten im Jahre 1476, Zürich, 1974.
G.
GROSJEAN, La bataille de Morat selon trois enluminures d'anciennes
chroniques suisses, Zurich, 1975.
F. de GINGINSla-SARRA, Dépêches des ambassadeurs
milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne de 1474 à
1477.
G. F. OCHSENBEIN, Die Akten der Belagerung und
Schlacht von Murten, Freiburg, 1876.
D. SCHILLING, Berner Chronik, 1483, Bern,
1945.
2. Ouvrages et articles
J.
BARTIER, Karl der Kühne, Genf, 1976.
Ch.
BRUSTEN, L'armée bourguignonne de 1465 à 1468, Bruxelles, 1954.
Ch.
BRUSTEN, À propos de la bataille de Morat. Publication du Centre européen
d'Études burgondomédianes, N°10, Bâle, 1968, pp. 79-83.
Grandson
- 1476. Essai d'approche pluridisciplinaire d'une action militaire
au XVe siècle, Lausanne, 1976.
La Bataille de Morat. Colloque
international du 5e centenaire. Actes, Freiburg
und Bern, 1976.
L.-E.
ROULET, Le duc René à la bataille de Morat. 500e anniversaire de la
bataille de Nancy, Nancy, 1977, pp. 415-428.
L.-E. ROULET, La route Berne-Genève et les guerres
de Bourgogne. Publication du Centre européen d'Études burgondo-médianes, N°23,
Bâle, . 1983, pp. 43-52.
W.
SCHAUFFELBERGER, Der alte Schweizer und sein Krieg, Zürich, 1966.
N.
STEIN, Burgund und die Eidgenossenschaft zur Zeit Karls des Kühnen, Frankfurt
am Main, 1979.
PUBLICATION
DU CENTRE EUR0PÉEN D'ÉTUDES BOURGUIGNONNES (XIVe - XVIe s.)
N° 2 6 - 1 9 8 6
RENCONTRES
DE BRUXELLES (19 au 22 septembre 1985): «Art de la guerre, technologie et
tactique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge
et à la Renaissance»
Actes
publiés sous la direction de Jean-Marie CAUCHIES Secrétaire général du
Centre
Bâle 1986
Éditeur:
Centre européen d'études bourguignonnes (XIVe - XVIe s.), Bâle Tous droits réservés
Imprimerie: Service d'Impression de l'Université Catholique de Louvain - LLN
Les fascicules sont en vente au secrétariat général du centre: Jean-Marie
CAUCHIES, Facultés universitaires Saint-Louis,
boulevard du Jardin
botanique, 43, B 1000 Bruxelles
Comptes
du Centre:
10-210'746.0
- Société de Banque suisse, Aeschenvorstadt, 1, CH 4051 Basel 676-4236601-92 -
Banque Degroof, rue de l'Industrie/Nijverheidstraat, 44, B 1040
Bruxelles/Brussel La cotisation annuelle (20 FS, 500 FB) comprend la livraison
du fascicule de l'année Tout fascicule supplémentaire: 20 FS, 500 FB
Collection complète (sauf n° 13, épuisé): 200 FS, 5000 FB